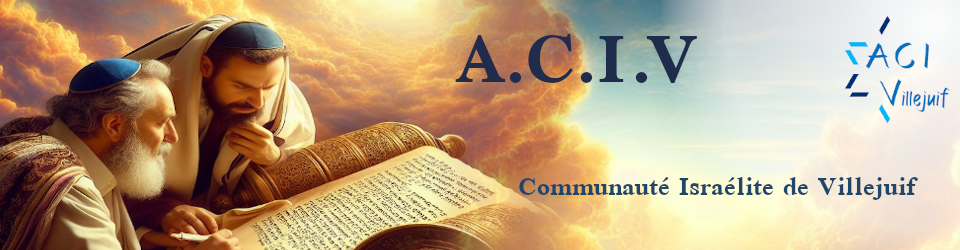Résumé de la Paracha YITRO
 Le beau-père de Moïse, Yitro, a eu connaissance des grands miracles accomplis par D.ieu pour les enfants d'Israël. Il quitte Midiane pour rejoindre le camp des Hébreux, accompagné de l'épouse de Moïse et de ses deux fils. Yitro conseille à son gendre d'établir une hiérarchie de magistrats et de juges qui l'assisteront dans sa tâche d'administrer le peuple et de rendre la justice.
Le beau-père de Moïse, Yitro, a eu connaissance des grands miracles accomplis par D.ieu pour les enfants d'Israël. Il quitte Midiane pour rejoindre le camp des Hébreux, accompagné de l'épouse de Moïse et de ses deux fils. Yitro conseille à son gendre d'établir une hiérarchie de magistrats et de juges qui l'assisteront dans sa tâche d'administrer le peuple et de rendre la justice.
Le peuple campe face au mont Sinaï. Moïse monte vers D.ieu et rapporte Sa parole : « Vous serez pour Moi un royaume de prêtres et une nation sainte ». Et le peuple répond « Tout ce que l'Éternel a dit nous le ferons ».
Le sixième jour du troisième mois (le mois de sivan), sept semaines après la Sortie d'Egypte, le peuple d’Israël est tout entier rassemblé au pied du Mont Sinaï.
Après trois jours de préparatifs intensifs, le peuple assiste à la Révélation de la parole de D. et entend la communication des Dix Commandements. Au milieu du tonnerre et des éclairs, la voix de D. ébranle les milliers de fils d'Israël qui demandent à Moïse de se faire leur interprète, car ils ne peuvent plus supporter l'ampleur de la parole du Maître
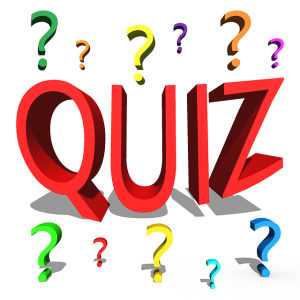 Les quiz de la semaine
Les quiz de la semaine
1. Quels évènements ont conduit Yitro à venir se joindre au peuple juif ?
2. Pourquoi Moïse a-t-il laissé sa femme et se enfants à Midian ?
3. Quel fut la réaction de Yitro lorsque Moïse lui apprit la destruction de l’Egyte ?
4. Quel fut le jour où Moïse siégea pour juger le peuple ?
5. De combien est plus la valeur de la récom-pense de celle du châtiment ?
6. Comment déduit-on que « tu ne voleras point » concerne la kidnapping et non pas le vol d’un bien matériel?
Commentaire de la Paracha YITRO
Texte: Chémot 18:1-20:23
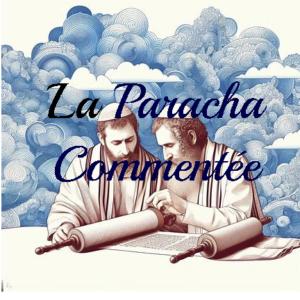 Imaginez un instant l'histoire non pas comme une ligne droite qui s'éloigne, mais comme un cercle où tout se rejoint. C’est ainsi que la tradition nous invite à percevoir la paracha Yitro : la Révélation au mont Sinaï n'est pas un souvenir poussiéreux, mais un événement qui se déroule encore aujourd’hui. Ce jour-là, ce n'est pas seulement un groupe d'hébreux qui se tenait au pied de la montagne, mais l'humanité entière.
Imaginez un instant l'histoire non pas comme une ligne droite qui s'éloigne, mais comme un cercle où tout se rejoint. C’est ainsi que la tradition nous invite à percevoir la paracha Yitro : la Révélation au mont Sinaï n'est pas un souvenir poussiéreux, mais un événement qui se déroule encore aujourd’hui. Ce jour-là, ce n'est pas seulement un groupe d'hébreux qui se tenait au pied de la montagne, mais l'humanité entière.
La tradition raconte que toutes les âmes, passées comme futures, étaient présentes pour recevoir leur propre fragment de vérité. On peut ainsi concevoir la Torah comme un texte d’une complexité infinie où chaque lettre, à l’image de chaque âme humaine, est absolument indispensable à l’intégrité de l’ensemble, ou chaque existence représente une lettre unique et irremplaçable ; sans cette note singulière, la symphonie de la création sonnerait faux.
Pourtant, porter cette lettre unique n’est pas toujours confortable. Le grand défi de l’être humain, hier comme aujourd’hui, est cette tendance presque instinctive à fuir ses responsabilités. Il est tellement plus simple de pointer du doigt les circonstances, la chance ou les autres pour justifier les silences ou les manques. La Bible elle-même montre des figures majeures qui, au début, ont voulu reculer devant leur mission. Mais le message est clair : cette fuite est le principal obstacle à l’épanouissement. En rejetant la faute sur l'extérieur, l'individu se prive de son propre pouvoir d'agir.
La sagesse qui nous a été transmise n’est pas un objet figé dans une vitrine de musée. Elle ressemble plutôt à une source qui coule et s’adapte au terrain qu’elle traverse. À chaque époque, à chaque génération, c’est à nous de découvrir la part de vérité qui était restée "en attente" jusqu'à notre venue. Le monde n'attend pas que nous répétions simplement le passé, mais que nous actualisions ce message dans le présent,
À l'image de Yitro, qui a quitté son confort pour embrasser une vérité exigeante, la responsabilité individuelle apparaît comme le critère ultime de l'intégrité. Dans un monde marqué par la passivité, il est essentiel de comprendre que chaque pensée et chaque acte pèsent sur l'équilibre universel. L’enseignement majeur est que l'engagement personnel constitue la voie unique de l'accomplissement : en refusant les excuses et en assumant sa part, chacun permet à sa propre « lettre » de briller, car c'est par l'action concrète que la lumière se révèle véritablement au cœur de l'existence.
d’après Rabbi Chaim Richman Jerusalem lights ; https://youtu.be/Gi8Cep6vGEs
Commentaire de la Haftara YITRO
Texte: Bichnat mot. Isaïe 6:1-13
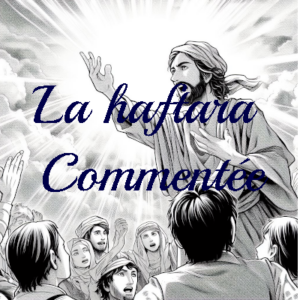 La haftara de cette semaine, tirée du livre d’Isaïe, nous transporte au cœur du Temple, lors de la vision inaugurale du prophète.
La haftara de cette semaine, tirée du livre d’Isaïe, nous transporte au cœur du Temple, lors de la vision inaugurale du prophète.
Témoin de la sainteté absolue de Dieu proclamée par les séraphins, Isaïe prend alors conscience de son indignité et de celle de son peuple. Il se définit alors comme un homme aux lèvres impures vivant au milieu d'un peuple aux lèvres souillées. Pour répondre à cette détresse et préparer Isaïe à sa mission, un ange saisit un charbon ardent sur l’autel et vient purifier le prophète : « Il en toucha ma bouche et dit : "Ceci a touché tes lèvres ; ton iniquité est enlevée et ton péché est expié" » (6, 7).
Ce verset est cité dans une discussion du talmud au sein du traité « Kallah Rabbati » (6, 10). Ce traité fait partie des « petits traités » qui se concentrent sur l’éthique, la pudeur et les règles de conduite morale.
Dans cette discussion, les Sages explorent la question complexe de la responsabilité collective des justes envers leur génération. La tradition rabbinique indique que le juste ne vit pas en vase clos, mais qu'il est lié au sort de ses contemporains. Dans ce cadre, le Talmud porte un regard critique sur l'attitude initiale d'Isaïe. On y apprend que le prophète fut sanctionné pour avoir utilisé des termes dégradants envers le peuple d'Israël, le qualifiant notamment de « race de malfaiteurs » ou de « fils de l’enchanteresse ». Pour les Sages, même si le constat du prophète était factuellement exact, sa manière de condamner la communauté sans chercher à la défendre constituait une faute spirituelle.
Le verset 6:7 ci-dessus est alors cité pour indiquer que Dieu a pardonné au prophète et l'a purifié avant de lui confier sa mission.
Ce que nous enseigne cette confrontation c’est que la vérité, lorsqu'elle est dépourvue de bienveillance, peut devenir une faute. Déceler les manquements d'autrui est aisé, mais les dénoncer avec distance peut s'avérer destructeur. Le Talmud nous rappelle que celui qui aspire à la droiture ou à une position de guide porte une responsabilité accrue : celle de protéger l'honneur de ses semblables plutôt que de se contenter d'en exposer les plaies. La purification des lèvres d'Isaïe suggère que pour que notre parole soit légitime, elle doit d'abord être passée au feu de l'empathie. Ainsi la véritable grandeur ne réside pas dans la capacité à juger le monde, mais dans la volonté d'assumer sa part de responsabilité collective,
d’après sources diverses/
Réponses aux quiz
1. V18 :1. L’ouverture de la mer rouge et la guerre contre Amalek.
2. V 18 :3. Il a suivi le conseil d’Aaron qui lui dit que la peine qui accablait les hébreux en Egypte était suffisante et qu’il ne fallait faire subir cela à sa propre famille.
3. V 18 :9. Il eut du chagrin, car il était attaché à la grandeur de l’Egypte.
4. V 18 :13. Le lendemain du jour de Kippour.
5. V 20 :6. 500 fois
6. V 20 :13. Car ce commandement est suivi de « tu ne tueras point » et « tu ne commettras pas d’adultère » ; il s’agit donc de fautes qui sont punis de la peine de mort, ce qui n’est pas le cas du vol